

Instant nostalgie : le premier album de James Blake a 10 ans
Régulièrement cité parmi les plus grands albums du début des années 2010, le premier album éponyme de James Blake a dix ans. L'occasion de revenir sur ce chef-d'œuvre minimaliste, qui marque le début d'une décennie de triomphe pour le crooner anglais.
2021 M02 9
En 2011, cela fait déjà quelques mois que son nom est mentionné dans les coulisses de l'industrie musicale. Le phénomène dubstep est à son climax et James Blake, lui, en propose une version ralentie à l'extrême, nettement plus mélancolique, presque sentimentale par instant. Tout le monde sent bien que quelque chose se passe avec ce grand anglais, au teint pâle et à l'allure frêle.
On se dit qu'il y a un coup à faire, si bien qu'Universal n'hésite pas à mettre le paquet pour enrôler ce nouveau prodige venu d'outre-Manche, prêt à exporter son genre musical hors de ses frontières, comme peu d'artistes (ni Burial, ni Mount Kimbie ou Darkstar n'y parviennent réellement) avant lui. « Tous les pays n'ont pas saisi le dubstep, parce qu'il leur manque la culture dub qui en est la base », expliquait-t-il alors à Libération.
Comme souvent, la hype James Blake ne se fait pas sans la vindicte de quelques haters, Geoff Barrow (Portishead, Beak>) en tête, qui se demande alors si l'on se rappellera de 2010 comme de « la décennie où le dubstep rencontra les chanteurs de pub ».
Au fond, qu'importe si la campagne communicationnelle d'Universal paraît un peu forcée (des publicités dans le métro de Londres, des Unes des magazines, etc.), un peu comme un collectionneur prêt à tout faire pour signaler l'acquisition d'un nouveau joujou, la réalité est indéniable : à 23 ans, le Londonien parvient à déployer un univers extrêmement marqué, profond, fait de voix filtrées, de basses puissantes, d’inclinaisons soul et de mélodies en contretemps.
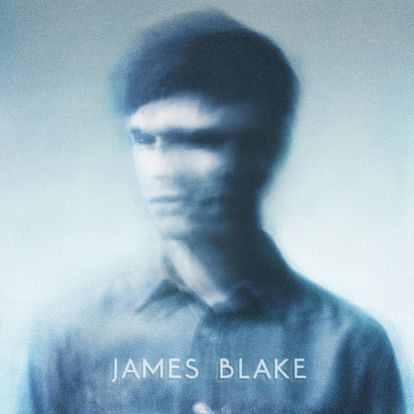
À l'époque, certains critiques comparent ce premier album éponyme à « Vespertine » de Björk et « Kid A » de qui vous savez. C'est vrai que des morceaux tels que Unluck, To Care (I Like You) ou Limit To Your Love (emprunté à Feist) annoncent eux aussi un basculement, l’entrée dans un nouveau monde, une sorte de blues digital dans lequel nombre d’artistes ne manqueront pas de s’engouffrer (Fyfe, Rhye, Sampha). Sauf que là où l’Islandaise et Radiohead imaginaient un futur à base de mélodies, si ce n’est complexes, du moins riches en détails, James Blake, lui, opte pour l’épure, jouant au crooner sensible dans le dénuement le plus total.
Il faut ainsi tendre une oreille attentive à I Never Leant To Share ou The Wilhelm Scream (une reprise d'un morceau de son père) pour comprendre à quel point l'Anglais aime le silence, les notes espacées. Les temps morts, en quelque sorte, appelons ça ainsi : après tout, James Blake a appris le piano à travers les compositions d'Erik Satie, véritable spécialiste de ces compositions qui s'autorisent la lenteur.
Sur le fond, James Blake ne débarque pas de nulle part non plus. Son univers, il le doit en partie au grand nom de la soul (Sam Cooke, Stevie Wonder), à quelques bidouilleurs électroniques (Four Tet, Aphex Twin), ainsi qu’à ces artistes R&B qui ont rénové le genre à la fin des années 1990 (Aaliyah et Kelis, chez qui il sample divers éléments sur CMYK).
Et pourtant, tout ici, paraît inédit (on parle alors de post-dubsep), sans doute parce qu'il fallait une certaine audace pour oser chanter de telles confessions (« Mon frère et ma sœur ne me parlent pas, mais je ne les blâme pas ») sur des sons fragmentés, censés mettre en exergue chaque mot (semblable à des haïikus), renforcer l'introspection et accentuer cette façon d'évoluer en équilibre stable entre l'introspection et la dématérialisation (d'une voix, d'un son), entre l'intimité et l'universel. Autant d'obsessions que James Blake ne cessera d'explorer par la suite, avec toujours cette science du pas de côté, du contrepieds, qui lui permettra d'infuser ses codes dans la musique des autres (Bon Iver, Rosalía, Metro Boomin).




